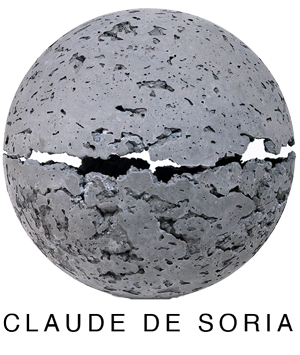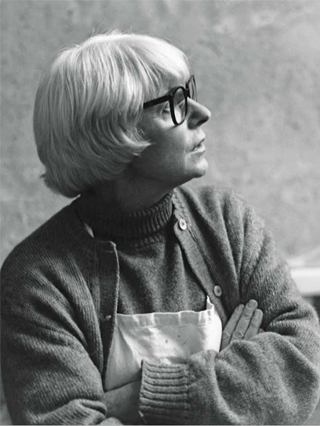Exposition à la Galerie Montenay du 7 au 30 mars 1991
Voici donc qu’un travail se poursuit. Obstiné, enserrant de sa fidélité une marche sans concession. Année après année, se célèbre le sacre d’une nouvelle virginité. Il tend, non seulement à dégager des figures inédites mais aussi à révéler la constance d’un sens. Celui d’un enjeu lié au péril et au hasard.
L’expérience générique de Claude de Soria face à son matériau, le ciment, est faite de conflits et de corps à corps. L’éclat de ces affrontements introduit la distance d’une double secousse. Celle de l’émerveillement (dans son sens étymologique tiré du latin populaire mirabilia = chose étonnante, phénomène inexplicable). Celle de l’insoupçonné. En même temps naît une rhétorique d’antinomies couplées. Elle est provoquée par la nature même du ciment : fuite/docilité, discrétion/persistance, légè- reté/profondeur, promptitude/stabilité, obscurité/clarté, opacité/transparence.
Derrière ces oppositions, les creusant, créant un affrontement plus cardinal encore jaillit la dualité du « ce qui est », « ce qui n’est pas ». Autrement dit : la matière dans son état poudreux, initial, et son devenir condensé, statufié, originellement imprévisible. En cours de travail se mettent en place l’obstacle, son questionnement, sa traversée. Pendant ce processus surgissent des fulgurances, des dialogues, cassures, contradictions, retraits, impatiences…
Depuis 1973, à partir du ciment, sont apparus différents moments, différents mondes. Différents, mais contenant le germe des figures à venir. Ainsi en fut-il des Plaques jusqu’aux Ouvertures, en passant par les Boules, Tiges, Lames et Contre-Lames. En ce printemps 1991, l’exposition se répartit en trois volets : les Lattes, les Aiguilles, les Empreintes.
Les Lattes (que pour ma part j’ai tendance à nommer voliges tant elles font songer aux lattes où se fixent les ardoises des toits), se dressent seules ou se déploient en diptyques ou triptyques. Ces sculptures longues, verticales, sont striées de scarifications, de lignes de clivages, fines, dont le thème pourrait être celui d’une obsédante interrogation de l’intervalle. Ces traits horizontaux (quelquefois très légèrement obliques) tendent à contrarier la verticalité des Lattes. Le spectateur observe ces volumes dans l’ordre ou le désordre —allant de l’un a l’autre à sa convenance, retournant sur ses pas, séparant mentalement les diptyques ou les triptyques— et perçoit les dominantes, les liens de parenté, plus ou moins étroits entre chaque sculpture. Cependant dans la verticalité répétée et déstabilisée, quelque chose, toujours, échappe à la stricte cohérence logique. Tantôt c’est la matière et son grain, tantôt c’est la figure —pure ligne géométrique proche du minéral, s’élevant comme un portique, un mégalithe, un mur, enracinés dans la terre —, qui viennent au devant du regard.
Ce genre d’étrangeté remet en cause le sens même de l’espace. Un sens vital et obscur, qui fait, par exemple, que d’instinct on sait où est le haut et le bas, la gauche et la droite, etc. C’est depuis longtemps un enjeu philosophique de déterminer « d’où » vient ce sens apparemment inné, ou alors acquis dans les premières années de l’existence, grâce auquel on peut non seulement se repérer, mais tout simplement se tenir debout, marcher.
Les Aiguilles se réalisent dans la nécessité d’une hâte technique. L’artiste, après avoir répandu la pâte de ciment sur une plaque doit freiner sa course avant solidification (« la prise »). Elle saisit le matériau par ses bords, les infléchit vers l’intérieur. Cet arrêt du mouvement, son orientation du Ià-bas vers l’ici-dedans, creuse un sillon. Il s’épanouit à vue comme une houle hospitalière. Le regard s’enfonce dans l’excavation. Elle s’ouvre davantage. S’exclame comme une vague, une flèche lancée par la mer, comme un fruit qui éclate et nous révèle le cristal de sa nuit.
Les Empreintes sont directement issues des Lattes. Ces fragments de feuilles translucides ont permis, par leur mise en place les uns au-dessus des autres (justement comme les ardoises ou les tuiles sur les voliges), de donner naissance aux lignes, aux stries horizontales. Décollés du ciment, ils en conservent les bribes, les scories. Ces taches infimes parsèment la transparence. On pense à une condensation de l’air, mais solidifiée. Elle frôle l’espace et dans un même mouvement l’allège, le libère. Le mot « penser » évoque un équilibre et une pensée. Et, tout bien pesé, que pèse l’air ? Que représente-t-il ? Le Tout ? Soleil et terre, grains et étoiles ? Ou ce geste minime de prendre du sable pour le laisser filer entre les doigts, signe que la totalité à portée de main est, à jamais, insaisissable.
Claude Bouyeure