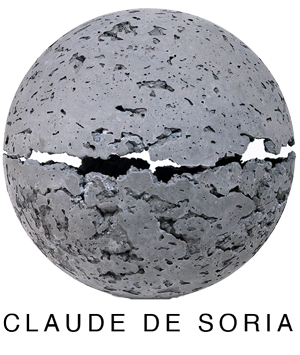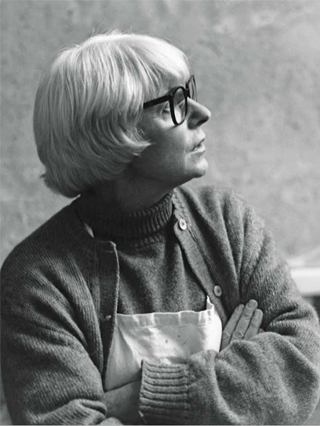Entretien avec Claude de Soria
Propos recueillis par Philippe Cyroulnik en 1979.
Claude de Soria : – Pour moi, le fait que les gens aient envie de toucher une sculpture, la valorise. Il est catastrophique que les gardiens de musée empêchent de toucher une sculpture, car il n’y a même pas le risque de l’abîmer comme cela pourrait être le cas pour la peinture. C’est une envie très naturelle à partir du moment où c’est de la vraie sculpture.
Philippe Cyroulnik : – Qu’entends-tu par vraie sculpture ?
Claude de Soria : – Par exemple pour mes plaques, je me suis demandé ce que c’était : était-ce de la sculpture ? de la peinture ? Finalement ce n’est peut-être pas que de la sculpture, mais c’en est quand même ? Et le fait que les gens aient cette envie de toucher, constitue une preuve pour moi.
P.C. : – Peux-tu me dire comment tu procèdes pour les plaques ?
C.d.S. : – C’est une chose que j’ai découverte par hasard et une explication complète renverrait à toute mon histoire. Restons-en simplement à la fabrication, à la manière dont une plaque naît. Je mélange du ciment, du sable et de l’eau dans une cuvette ronde. Je la mets sous le robinet, je verse de l’eau et je « touille » jusqu’à ce que cela ait l’épaisseur voulue. En général je recherche toujours la même épaisseur, le même mélange. Ensuite je prépare une feuille de plastique souple et relativement épaisse, que je place sur une sellette. Je renverse ma cuve dessus comme les enfants renversent leur pot de sable sur la plage. La flaque de ciment assez épaisse s’étale ; je l’aide à s’étaler très lentement, en tapant dessus avec une truelle très doucement pour ne pas gêner son mouvement naturel. Comme la forme de la cuvette est ronde, ça continue à s’étaler en rond. Je laisse sécher environ 48 heures. Ensuite je retourne l’ensemble, soulève la plaque de plastique et j’ai deux résultats. D’une part, la plaque de ciment, d’autre part le plastique qui, à cause des réactions chimiques et de la légère chaleur dégagée par le ciment, s’est retrouvé altéré par le ciment et existe comme une radiographie de ma plaque ; avec la preuve qui est très importante pour moi, que je n’ai pas peint ma plaque, que tous les accidents, y compris l’auréole qui se forme autour, sont indépendants de ma « volonté ». Il m’importe beaucoup que l’on voit que les choses se font naturellement. Elles se font naturellement en accord avec moi. Il y a fusion, interaction entre la matière et moi, entre le matériau et moi. C’est une très grande source de satisfaction pour moi.
P.C. : – Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est qu’il y a des creux et des trous dans la plaque de ciment, qui restent, qui te reviennent d’une adhérence de la matière sur le plastique.
C.d.S. : – C’est ça.
P.C. : – Cela me semble important : ce qui fonctionne comme inscription d’une matière sur une surface plastique, surface du support, est en même temps ce qui est perdu dans la plaque de ciment. Il y a donc à la fois la présence de deux éléments : l’un qui, dans ta plaque de ciment, est un élément de perte, l’autre qui, sur ta plaque de plastique, devient une présence pleine.
C.d.S. : – Oui, mais cela n’est valable que pour les accidents, sous forme de tâches. Il y a aussi toute la coloration, qui, elle, n’obéit plus à ce que tu dis. Ce que tu avances, est surtout juste pour les bulles. Par contre, toute cette coloration là, par quel miracle est-ce que cela marche ? On n’en sait rien.
P.C. : – Malgré cette différence de fonctionnement, il y a une sorte de report ; sous un certain angle, c’est la même chose que ta plaque de ciment, tout en étant son reflet différent. Dans cette différence, je retrouve l’idée d’une sorte d’altérité : cette même chose qui s’altère en se donnant comme reproduction, comme empreinte. Comme si la matrice s’altérait pour devenir autre chose.
C.d.S. : – Mais en même temps cela a une existence propre. C’est pourquoi je ne suis pas contre les exposer séparément. Au départ, je les lavais consciencieusement pour recommencer. Il se trouve que c’est par hasard que j’ai gardé les empreintes. Jean Degottex est venu me voir et m’a dit qu’il « aimerait bien savoir comment ça se fait ». Alors je lui ai montré une empreinte que je n’avais pas lavée et lui ai dit : « voilà, vous avez la preuve de mon travail ». Il m’a dit : « c’est très intéressant, il faut absolument que vous gardiez les empreintes. Il faut les garder et les exposer en même temps ». Moi, je n’en avais pas perçu l’importance. Il m’en a fait prendre conscience.
P.C. : – En fin de compte, c’est une sorte de dédoublement du travail propre du matériau. Par deux fois, le matériau joue à plein de lui-même, avec ses propres incertitudes quant au résultat, quant au processus de transformation du mou au dur par exemple.
C.d.S. : – C’est cela.
P.C. : – Dans la plupart de tes sculptures récentes, il y a une forme qui revient tout le temps, c’est le cercle, la sphère. Est-ce une forme qui est venue par hasard et que tu as accepté comme telle, ou y a-t-il quelque chose qui t ‘intéresse plus précisément dans ce type de forme ?
C.d.S. : – C’est un thème qui revient toujours chez moi. Toute l’histoire de mon travail dans la sculpture est inscrite dans la réponse à la question que tu poses…
J’ai commencé par faire de la peinture. J’ai travaillé chez Lhote, chez Léger ; puis chez Zadkine, j’ai fait une année de sculpture avec modèle vivant, où j’ai vraiment découvert que j’étais faite pour la sculpture. Ensuite je suis partie en province et je me suis arrêtée de travailler pendant dix ans, avec beaucoup de problèmes personnels.
Quand je suis revenue à Paris, j’ai décidé de refaire de la sculpture et me suis précipitée chez Zadkine qui, miraculeusement n’enseignait plus. J’ai donc dû me jeter à l’eau toute seule. À cette époque, je n’avais aucune envie de faire des choses non figuratives. Je voulais continuer mon travail là où je l’avais laissé, c’est-à-dire avec le modèle. Mais avoir chez moi quelqu’un posant dans une petite pièce de mon appartement me semblait problématique. J’ai donc eu l’idée d’utiliser des boutons de fleurs qui s’ouvrent et se ferment comme des tulipes, ou des boutons pleins de muscles prêts à s’ouvrir, à s’éclater. Cela a duré un an, puis j’ai fini par ne faire que des boules informes qui m’ont impressionnée, j’ai donc décidé d’arrêter ces boules. Ensuite, pendant assez longtemps, j’ai fait des torses, des figures humaines, imaginaires. Sortant de l’exposition Picasso et regardant le catalogue, je suis emballée par un torse d’homme avec toutes les indications, données par le coup de pinceau, de la sculpture que Picasso crevait d’envie de faire à cette époque, et qu’il n’avait pas encore faite. Je me suis offert quinze jours de leçons de sculpture formidables, à rétablir en relief la peinture de Picasso d’après les coups de pinceau. C’était passionnant. Je découvrais, à travailler sur l’œuvre de Picasso, sur l’œuvre d’un autre, le sentiment paradoxal que je m’exprimais comme jamais je ne l’avais fait jusqu’alors. Dans la foulée, je faisais une transposition d’une nature morte de Picasso, avec le même bonheur et émerveillement. Mon problème était dès lors : que faire ? « Je ne peux pas passer ma vie à faire des Picasso, et je n’ai pas envie de continuer mes torses et mes boutons de fleurs ». On est en 1968. Je reçois le faire-part d’une exposition d’Hantaï à la galerie Fournier, avec une superbe photo. Sur celle-ci il y avait des toiles qu’il faisait sécher en les suspendant à un clou et qui prenaient des formes merveilleuses. Malheureusement, je les ai trouvées tendues sur des châssis à l’exposition. Mais à l’époque de la photo elles étaient suspendues souples. Au reçu de cette photo, je prends de la terre et je fais, sans réfléchir à ce que je fais, ma première sculpture abstraite d’après la photo d’Hantaï. Je fais une deuxième sculpture, encore plus poussée dans la représentation des formes de toiles suspendues les unes à côté des autres. Je me dis du coup qu’il serait intéressant de tenter de faire des murs, puisque je recopiais des formes qui étaient suspendues le long d’un mur. Je commence à préparer selon la manière traditionnelle, je m’énerve, commence à taper et à faire quelque chose de totalement différent, qui n’a aucun rapport avec la réalité. J’avais donc fait un énorme pas en avant : libérée de l’obligation d’un support réaliste, je me suis embarquée dans cette nouvelle direction. J’ai fait beaucoup de plaques comme cela, dont une qui est très importante pour moi : elle était assez épaisse et je me suis dit : « je vais faire l’endroit et l’envers. Je l’ai donnée à cuire ensuite. Elle m’est revenue blanche alors qu’elle était grise en terre sèche. Je regarde l’endroit, puis la retourne et m’aperçois que tout ce que j’avais à dire, toute ma violence est sortie à l’envers, qui ne devait théoriquement pas être vu, qui devait rester caché. Pourquoi ? Dans quel état devrais-je être quand j’ai fait cette œuvre ? … pour que beaucoup de choses de moi passent dedans en comparaison de l’endroit, sage, intéressant, bien équilibré, etc… La réflexion m’a fait comprendre que dans l’envers, j’étais totalement absente de ce que je faisais, débarrassée de toute fonction de censure ou de sens critique, ignorant ce qu’on m’avait appris pour corriger ce que j’étais en train de faire… j’avais été complètement libre. J’ai voulu retrouver cet état d’absence de ma volonté et de sens critique. J’ai donc commencé à faire des empreintes de « dessous » de sculptures. Avec ces empreintes je recherchais un résultat pour lequel je n’avais pas consciemment travaillé. En effet, pendant ce travail, je ne pense pas à ce qui va rester de reliefs superficiels qui vont accrocher le rouleau d’encre. Quand je passe mon rouleau et que j’ai un résultat, c’est vraiment le hasard. Cependant pas tout-à-fait, puisque c’est moi qui ai fait toutes ces formes, et que l’empreinte dépend de toutes les crêtes de mon relief.
Puis je me suis dit que je n’étais pas là que pour faire des reliefs, qu’en tant que sculpteur, la ronde-bosse devait m’intéresser : faisant des boules avant, j’ai voulu en refaire. Pendant toute une période, j’ai donc essayé de faire des boules en bronze, sans jamais y parvenir. J’étais obligée de les égratigner, de les démolir, de les sculpter jusqu’à ce que j’arrive à en faire une. Je me dis que le bronze ne me convient pas et commence à avoir le dégoût pour tout effort pour « faire de la sculpture ». Me reculer et juger pour savoir si un relief est intéressant selon les critères de la sculpture traditionnelle, me donnait envie de vomir. Ce n’était plus possible. La seule chose que je pouvais faire, c’était de prendre un morceau de terre entre mes mains et d’appuyer. Cela s’étalait comme une surface plate qui s’arrêtait quand je n’avais plus de terre dans la main, ou alors qui prenait vaguement la forme d’un contenant. Tout ceci très « mal fait », car je ne supportais pas de faire « bien ». C’était un dégoût physique avoisinant la nausée. J’étais obligée de piquer la terre par endroits pur éviter qu’elle ne craque à la cuisson, à cause des bulles. Mais je rejetais toute application. Insatisfaite, je pense à changer de matériau. Je me sentais proche de la terre. Je me suis mise à réfléchir : la terre c’est trop fragile, puisque j’en fais une espèce de dentelle en ce moment… Pourquoi ne pas tenter le ciment ? lui qui se mélange à la terre et à l’eau. Et voilà que je commence à m’intéresser au ciment… J’essaye de recouvrir des grillages avec du ciment, mais il dégouline. J’ai beau faire mille tentatives, cela ne marche pas. En désespoir de cause, je tente de faire des murs ou des plaques comme avec la terre, faisant en sorte que la quantité de ciment soit suffisamment épaisse pour que mes reliefs soient marqués. Je fabrique un peu de ciment dans une toute petite jatte que je renverse sur la seule surface propre de l’atelier : une plaque de verre. J’essaye de faire des creux qui immédiatement, se fondent les uns dans les autres. Il était tard, et c’était dégueulasse. J’ai laissé cela en me disant que le lendemain, je l’enlèverais beaucoup plus facilement du verre et que je le jetterais. Le lendemain j’essaye de le soulever du verre, ça adhère tellement que je sis obligée de prendre une lame de rasoir pour le détacher du verre. Et je trouve ce résultat avec toutes ces bulles, toute cette vie extraordinaire. C’est le ciel, c’est le fond de la mer… En tout cas, c’est éclatant de vie… Miraculeux. Je suis en présence d’une chose de la nature et d’une telle beauté, avec ce ton gris superbe, que je veux en faire d’autres. Je fais des plaques de petite dimension, et ensuite mon obsession de la ronde-bosse me reprend. J’en ai assez de faire des « assiettes ». Il faut que je moule mon ciment dans quelque chose qui ait une forme. Ne trouvant pas de contenant pour mouler mon élément, j’envisage de le faire couler dans un tissu de plastique. Je pourrai peut-être travailler le plastique avec mes mains ? Ensuite, une fois sec, par assemblage de plusieurs formes obtenues de cette manière, je pourrai faire une sculpture. Je fais tomber mon ciment moyennement liquide dans un tissu de plastique. Quand il tombe, je passe ma main dessous et m’aperçois que cela fait une boule ; je resserre le dessus pour que tout soit en contact avec le plastique, qu’il n’y ait pas d’air, que la forme soit entièrement cernée. Quand elle est sèche, je la démoule en me demandant où je vais, car je commence à fabriquer des choses sans y mettre la main. Est-ce que c’est vraiment moi ? Est-ce que je me laisse influencer par des productions contemporaines ? Très excitée, je démoule rapidement la première boule : c’était mon bouton de fleur d’il y a cinq ans ! J’étais stupéfaite, bouleversée. Par un chemin entièrement différent, je me retrouvais complètement. J’ai continué à faire beaucoup de boules, que j’appelais des fruits. Ensuite j’ai voulu faire des grandes plaques. Jusque là je les avais faites sur du verre et il était très difficile de les séparer du verre. C’est pour cela que j’ai eu l’idée du plastique, dont la surface est lisse comme celle du verre et qui est souple. La première fois que je renversais une grande bassine de ciment sur du plastique, j’ai eu la joie de découvrir que j’obtenais sur la plaque de ciment une auréole qui me fermait merveilleusement ma forme, auréole que je n’obtenais pas sur le verre. Il se trouve que j’ai fait toute une série de grandes plaques pour l’exposition à la galerie Germain, et qu’en allant me procurer du rhodoïd chez le marchand de couleurs, j’ai aperçu des demi-sphères en plastique à vendre : c’était mes boules ! Voilà comment sont apparues mes boules de ciment en deux parties, qui, elle aussi, ressemblaient à mes anciennes sculptures en terre.
P.C. : – N’y a-t-il pas là un certain retrait de la subjectivité au profit d’une logique propre de la matière ? Non pas qu’il n’y ait pas singularité d’une démarche, mais prise en charge par le travail du « travail » du matériau lui-même ? Une mise à l’écart de ce côté démiurgique de sculpteur « travaillant » la matière et faisant une « œuvre » comme si la matière n’était qu’un médium sans existence propre.
C.d.S. : – On peut dire qu’il y a autant de démiurgie à découvrir le plaisir et la manière de travailler avec le matériau, c’est-à-dire de faire que le matériau travaille avec soi, accepte de se livrer et de donner un témoignage de vie. Je trouve qu’effectivement dans cette prédominance de la matière dans le travail, il y a des rapports entre un certain nombre de sculpteurs, de peintres et moi. Cela pouvait se voir à l’exposition « Paris, Travaux 77 » à l’A.R.C.
P.C. : – À propos de la forme sur laquelle tu travailles, la forme ronde, sphérique, et à propos de cet envers caché, tu as dit tout à l’heure, quelque chose de très intéressant, à savoir que c’était essentiellement l’envers qui se travaillait. C’est dans tout ce qui est « secondaire », qui ne devait pas être vu, que s’est investie une masse de pulsions, de violence et de créativité possible. Je te pose cette question en rapport avec la façon dont tu peux vivre ta situation de sculpteur, de femme dans la sculpture. N’y a-t-il pas pour toi présence de cette question ?
C.d.S. : – Consciemment non. Mais on peut dire qu’il y a une fusion, un passage de mon inconscient dans le matériau, très important il me semble, dans l’anonymat de l’envers.
P.C. : – Tu parles d’anonymat et d’envers, et tu emploies les mots censure et sens critique.
C.d.S. : – Oui, je dois supprimer ce qui m’entoure, tout ce que j’ai appris ; c’est un peu idiot, car mon inconscient est aussi formé par tout cela. L’important pur moi, c’est de pouvoir me débarrasser de tout ce qui est extérieur lorsque je travaille.
P.C. : – J’aurais envie de parler aussi de « l’endroit » d’une personne. Cela renvoie à l’instance de la représentation, du savoir-faire, du code, du normal. Cet attrait pour l’envers, on pourrait dire le non-nommé, l’in-nommable, ce travail sur ce qui est magmatique, chaotique, vient perturber ce qui, dans la sculpture, relève du structuré et de l’ordonnancé.
C.d.S. : – Je ne dirais pas perturber. C’est l’ordre social, ce qu’on m’a appris qui perturbe ma vie propre.
P.C. : – Oui, mais c’est cet envers là qui relève de la perturbation du social. Il s’exhibe violemment par rapport à la linéarité du social.
C.d.S. : – Je suis d’accord, mais mon problème dans ma vie ne se situait pas seulement au niveau de mon insertion sociale, mais plus à celui de mes activités de créateur. Mon drame était surtout que je n’arrivais pas à travailler, donc à vivre, et pendant dix ans je me suis arrêtée. Ensuite, je me suis remise au travail et j’ai découvert dans le contact avec le matériau une manière de m’exprimer le plus totalement possible.